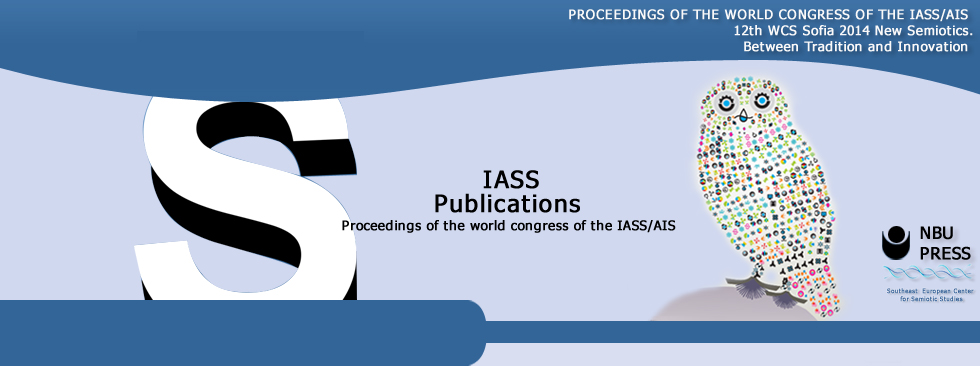A QUELLE DISTANCE SOMMES-NOUS DE LA SEMIOLOGIE DU CINEMA ?
Sorbonne Nouvelle-Paris 3, France
francois.jost@univ-paris3.fr
Abstract
Cette conférence vise à rendre compte d’un parcours : non pas celui qui nous rapproche d’un but inaccessible que serait la sémiologie du cinéma, mais l’itinéraire qui nous en éloigne. Le terminus a quo est évidemment la sémiologie metzienne qui, par défaut, était une sémiologie du cinéma, persuadé qu’en était son auteur, que la télévision et l’audiovisuel en général, quel que soit le genre, ne s’en écartaient pas.
Le terminus ad quem est la télévision et certaines formes audiovisuelles présentes sur internet qui sont aujourd’hui mon objet.
Entre les deux : « l’aventure sémiologique », comme aurait dit un de ses fondateurs, avec ses péripéties, ses rebondissements et sa sérendipité.
Le titre de mon intervention est la parodie, qui peut-être échappera aux plus jeunes, du titre d’un article de Christian Metz publié en 1976 : « À quelle distance en sommes-nous d’une possibilité réelle de formalisation? ». Pour le sémiologue, le terminus ad quem de la discipline était bien cette formalisation, qui lui donnerait cette allure scientifique représentée par une écriture d’où disparaîtrait toute subjectivité. Vu sous cet angle, ce titre représente parfaitement son époque : ce rêve des sciences humaines de devenir aussi « dures » que les sciences exactes, ce rêve de la sémiologie d’être une nouvelle linguistique, ce rêve du chercheur de s’effacer derrière son texte, conforme à l’idéologie alors en vigueur de la mort de l’auteur.
De l’eau a coulé sous les ponts : le structuralisme est aujourd’hui régulièrement vilipendé, prendre plaisir à un texte n’est plus une activité honteuse et l’on annonce périodiquement la fin du cinéma. Dans ce contexte, auquel, comme on sait peut-être, je prends ma part, le titre de mon exposé ne garde de celui de Metz que l’apparence et il signifie autre chose, si ce n’est exactement le contraire. La question n’est pas pour moi de savoir quand nous arriverons à formaliser le langage cinématographique, mais plutôt de prendre ses distances par rapport à cette sémiologie initiale et, si j’ose dire, initiatique. C’est donc plutôt d’un mouvement centrifuge que je veux vous parler, de l’éloignement progressif qui a animé ma démarche depuis quarante ans (car cela fait plus de quarante ans que je publie de la sémiologie).
Je n’ai personnellement jamais été metzien. Dès mes premiers écrits il m’est apparu que ce que Metz appelait cinéma n’était en fait qu’une région très limitée de ce que l’on pouvait appeler cinéma. Dès que j’ai essayé de faire fonctionner les concepts metziens dans le cadre d’un corpus de films dysnarratif comme ceux de Robbe-Grillet, rien ne fonctionnait : la liste des syntagmes recensés par Metz s’allongeait indéfiniment, la négligence du son devenait un obstacle à la formalisation, comme il le constata lui-même dans son analyse d’Adieu Philippine. Bref, il apparaissait clairement que la théorie de Metz ne s’appliquait qu’au film classique et, même, à une sorte de western imaginaire. Sans doute manquait-il des analyses textuelles, qui lui auraient permis d’éprouver ses concepts. En 1978, d’ailleurs, c’est-à-dire deux ans après l’article dont je suis parti, l’analyse textuelle submergea la théorie « pure » et je participai à ce mouvement en écrivant « la sémiologie remise en cause par l’analyse textuelle » (Jost 1978). Pour donner une idée des défauts auxquels donne lieu une réflexion purement théorique, on peut citer cette analyse du syntagme alternant, dont le meilleur exemple est pour Metz, la retransmission d’une partie de tennis. A-t-on jamais vu une telle mise en cadre pour filmer une partie de tennis ? Ni chez Hitchcock, ni à Roland Garros. Si deux caméras alternaient à chaque coup, le mal de tête serait inévitable et la compréhension du match impossible.
Ce que nous proposions alors avec Chateau était de faire une « nouvelle sémiologie », qui ne prenne plus comme unité minimale le plan, mais les paramètres audiovisuels (Chateau, Jost 1979). Ainsi, pour prendre un exemple, on pouvait montrer qu’un enchaînement de plans en continuité par une direction de mouvements d’un même personnage, pouvait être contredit par le changement de son costume entre les deux plans. Ce qui était alors exceptionnel chez Robbe-Grillet est devenu une sorte de cliché esthétique avec les clips, la publicité et même des séries américaines. Avec l’arrivée de la vidéo, où tout objet pouvait être incrusté par des éléments hétérogènes, la sémiologie des paramètres audiovisuels s’est imposée comme un cadre nécessaire, pour lequel le film classique n’est qu’une exception d’un processus général : par exemple, on peut différencier le flash-back classique des flash-backs « modernes » par le fait que le premier traite tous les paramètres en bloc, alors qu’Hiroshima, mon amour, par exemple, fait varier différentiellement le son selon les lieux. Il va de soi que, dans le contexte du numérique, la sémiologie du cinéma ne peut être que paramétrique.
Bien que la sémiologie du cinéma se soit développée dans le cadre du CECMAS (Centre d’Études de Communication de Masse), le concept de communication recouvre une autre acception que celle que nous lui donnons aujourd’hui. Dans le paradigme dominant de la linguistique de Jakobson, héritière de Shannon et Weaver, communiquer veut simplement dire encoder un message envoyé à un destinataire qui le décode. A l’époque tout est message ! Ce schéma aboutit au contraire de ce pour quoi il était fait, à la négation de toute communication. En effet, si comprendre un message c’est décoder ce qui a été codé, il n’est pas besoin de ce se préoccuper du destinateur ou du destinataire, il suffit d’étudier le message lui-même. D’où le principe d’immanence, qui, comme on sait, perdure dans le cadre d’une certaine sémiotique. Si le Pacte autobiographique ou Seuils ont fissuré cette théorie de la sémiologie originelle, la parution de La Chambre claire lui a donné un coup de boutoir décisif en admettant que la photographie n’était pas la même selon que l’on partait de l’intention de l’operator, du spectator ou du spectrum.
Pour moi, l’ère du doute est venue du laboratoire sémiotique que nous offrait la révolution roumaine de 1989. Lors de la retransmission du procès expéditif du couple Ceausescu, à certains moments les plans qui les représentaient se figeaient, proposant aux spectateurs des frozen shots. Une analyse selon les conclusions de la sémiologie aurait dit que le récit était alors suspendu, les images figées étant pour Gaudreault, dans la foulée de Metz, une suspension du récit : « l’on ne saurait les considérer [l’arrêt sur image ou le plan immobile] comme des énoncés narratifs » (1988 : 47).
Quelques jours plus tard, on sut la vérité : ces frozen shots étaient mis là où l’on aurait dû voir les plans des juges. Au lieu de les considérer comme une négation d’un énoncé narratif, il fallait plutôt les voir comme des actes d’énonciation narrative, des actes de censure. D’où la nécessité de repenser le schéma de communication et de l’actualiser avec une théorie plus adéquate, comme celle fournie, par exemple, par Sperber et Wilson à propos de la communication verbale, qui montre le rôle des inférences, des savoirs, de l’environnement cognitif partagé ou non par les acteurs de la communication. Pour cette première narratologie, signifier et raconter sont une seule et même chose. Mais, bientôt, la narratologie genettienne a pris son autonomie et a apporté un nouveau paradigme. Néanmoins, il faut souligner une autre idée reçue qui a obéré le développement de la discipline : la peur de l’anthropomorphisme. Le refus de prendre en compte l’intention, la volonté de construire un système scientifique qui tienne tout seul, la mort de l’auteur, etc. sont autant de raison qui ont poussé les chercheurs à repousser toute présence humaine, pourtant présupposée par les premiers écrits de Metz.
Plutôt que de considérer que les films sont des objets humains fabriqués pour dire, montrer, raconter quelque chose à d’autres hommes, Metz a préféré ne voir dans ceux-ci que des choses. La belle ambition première – comprendre comment on comprend – est devenue au fil des années : comprendre comment cela fonctionne indépendamment de toute présence humaine. De ce point de vue, la théorie de Metz a été d’une étonnante stabilité, persistant dans son être contre vents et marées, rétive à toute effet de mode. Le Signifiant imaginaire repose sur deux pétitions de principe :
• la première, empruntée à Jean-Louis Baudry, est que le spectateur s’identifie à la caméra. C’est l’identification primaire ;
• la seconde, que Metz développera d’une autre façon dans l’Énonciation impersonnelle, est que la communication cinématographique repose sur une absence : « l’acteur, le “décor”, les paroles qu’on entend, tout est absent, tout est enregistré » Metz 1977 : 63). C’est dans cette perspective qu’il peut soutenir que le film est un dispositif voyeuriste, qui repose sur « l’absence de l’objet vu » (ibid : 86) et sur le fait que, « le spectacle filmique, l’objet vu ignore son spectateur de façon plus radicale, puisqu’il n’est pas là, que ne peut faire le spectacle théâtral » (ibid. : 89).
Si, au lieu de se placer du point de vue du spectateur en salle, on se place du côté de la production, de la fabrication du film, on peut objecter facilement à Metz que tout spectacle cinématographique est d’abord un spectacle théâtral, pour le simple fait qu’il met l’acteur face à un public qui le regarde. C’est ce qui ressort de mon petit film « Lumière » La Première fois (disponible sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=xI3W9p_a-KM).
Dans La Première Fois, ce qui m’intéresse d’ailleurs, c’est le fait que, effectivement, cette jeune femme se déshabillait devant moi pour la première et aussi pour la dernière fois. D’où un très joli rosissement de ses joues au moment où elle choisit de retirer sa culotte. Au final, évidemment, le spectateur est loin de voir ce qu’a vu le metteur en scène et son inaccessibilité au hors champ lui est insolemment exhibée. Certains spectateurs, de dépit sans doute, croient d’ailleurs que la jeune femme, qui n’est pas une comédienne, mais une assistante parlementaire, fait semblant de se déshabiller, feint de se mettre nue.
Si je me permets ici de renvoyer à un de mes courts-métrages, c’est qu’il rend sensible, plus que les mots, me semble-t-il, que tout film, loin d’être le fait des anges, est d’abord un lieu théâtral, où tout ce qui est humain joue sur la réalité filmée : timidité, trac, arrogance ou peur. En la circonstance, l’émotion presque imperceptible que la caméra a captée n’est pas due à l’instrument de prise de vue, mais à ma présence : ce rosissement des joues est la trace visible de l’émotion d’une femme qui se déshabille devant un homme qu’elle ne connaît pas ou presque (je l’avais rencontrée la veille et nous avions parlé ensemble). Ce film pourrait aussi bien s’appeler Féminin/Masculin, dans la mesure où il rend sensible, le temps d’un regard, l’émotion que produit son déshabillage devant un homme qui revendique et assume sa position.
L’énonciation impersonnelle poursuit dans la même voie et aboutit à cet énoncé sans appel : « l’énonciateur, c’est le film », qui, une nouvelle fois, fait fi de tout processus communicationnel. C’est contre cette position, qui abouti chez Gaudreault à attribuer à des instances des passions humaines que l’on attribuait avant à l’auteur, que j’ai écrit Un monde à notre image (Jost 1992), qui plaide pour un « anthropomorphisme régulateur », sans lequel nous serions incapable d’apprécier un film, de faire notamment la différence entre une erreur et une intention. Et pourtant, qui n’a pas eu une discussion avec ses amis en sortant du cinéma pour déterminer si tel détail était « fait exprès » ou non, ce qui prouve bien nos besoins de reconstruire l’intention pour comprendre et évaluer un film. L’oubli de la communication, l’immanence, le refus mal compris de l’anthropomorphisme, toutes ces erreurs, si je peux dire, s’ancrent dans le fait que la sémiologie du cinéma s’est fondée sur la volonté de comprendre le langage cinématographique. Non pas le langage audiovisuel en général, mais le langage cinématographique mobilisé par un certain cinéma, indépendant de ses usages. Selon ce parti pris, télévision et cinéma « constituent, au moins dans leurs traits physiques essentiels, un seul et même langage » (1971 : 177) ; « l’image cinématographique et l’image télévisuelle ne diffèrent guère que par la taille » (Metz 1971 : 178).
De même qu’aucune partie de tennis n’est retransmise avec un syntagme alternant, il suffit de regarder Apostrophes, en 1976, pour voir que les règles d’enchaînement des plans sont bien différentes de celles du cinéma et que les « fautes de grammaire » (franchissement de l’axe des 180 degrés, erreurs de direction de regards) ne gênent nullement la compréhension. La sémiologie de la télévision n’a été possible qu’à partir du moment où l’on s’est défait de la sémiologie du cinéma, ce qui a pris quelque temps. Il est apparu à l’évidence que le propre de la télévision est d’abord sa capacité à diffuser tous les genres et que, si l’on restait au niveau du plan ou même des séquences on ne réussissait pas à saisir ce qui faisait sa spécificité. Je me souviens d’avoir expérimenté avec enthousiasme, dans les années 90, la capture automatique d’écran à l’Institut National de l’Audiovisuel. En visionnant un programme de télé, je capturais plusieurs centaines d’imagettes, refaisant une sorte de story bord. Très vite, je me suis aperçu que c’était un terminus a quo mais sûrement pas un terminus ad quem. Car cela ne disait pas grand-chose du programme. Il m’a alors fallu faire un zoom arrière et m’intéresser à un objet qui avait été totalement négligé par la sémiologie du cinéma, le genre. Cela a impliqué aussi un changement de paradigme car le genre est apparu comme un interprétant qui pouvait susciter des réceptions très différentes de la même séquence selon le monde auquel on la rattachait. J’ai quitté les rivages saussuriens pour rejoindre ceux de la sémiotique peircienne.
Pour terminer, je résume en quelques mots, les fondements, les présupposés de la sémiotique de la télévision que j’ai élaborés (Jost 2005) :
1. Tout genre repose sur la promesse d’une relation à un monde dont le mode ou le degré d’existence conditionne l’adhésion ou la participation du récepteur. En d’autres termes, un document, au sens large, qu’il soit écrit ou audiovisuel, est produit en fonction d’un type de croyance visée par le destinateur et, en retour, il ne peut être interprété par celui qui le reçoit sans une idée préalable du type de lien qui l’unit à la réalité.
2. Il existe trois interprétants au genre le monde réel, le monde fictif et le monde ludique.
3. Loin d’être fixée une fois pour toutes, la place des genres est variable selon le point de vue dont on les considère, et c’est ce qui fait de la communication télévisuelle autre chose qu’une chambre d’enregistrement dans laquelle le récepteur entérinerait la sémantisation des genres par l’émetteur.
4. La communication télévisuelle ne repose pas sur un contrat, mais sur une double promesse.
• une promesse ontologique. Cette promesse est contenue dans le nom de genre lui-même. Toute « comédie », par exemple, est une promesse de rire, indépendamment de la réussite effective de cette comédie.
• une promesse pragmatique. Une chose est de savoir ce qu’est le direct ou la fiction, une autre de déterminer si tel ou tel programme est un direct ou une fiction. La communication de la chaîne sur ses programmes est fondée sur une promesse d’appartenance de ces programmes à tel ou tel monde, promesse qu’elle effectue via les bandes-annonces, les dossiers de presse ou sa communication externe. Il suffit qu’elle étiquette un programme, direct, par exemple, pour que le spectateur soit incité à le regarder comme tel, même si ce n’est pas vrai.
J’ai dit au début qu’il fallait confronter la sémiologie à l’analyse textuelle. J’ajouterai qu’il faut toujours exporter les concepts vers d’autres champs pour voir quelle est leur validité. J’ai tenté de la faire en reprenant cette théorie des mondes pour le cinéma (Realta/finzione). Je pense que ce qui reste à travailler est notamment le pôle ludique. Celui-ci reste trop imprécis et il faudrait le creuser en fonction de la théorie des jeux.
Ce mouvement nous entraîne chaque jour un peu plus loin d’une sémiotique générale, mais qu’importe. L’abstraction a certes son charme, mais ce dont nous avons besoin pour comprendre les manifestations audiovisuelles aujourd’hui (je ne dis pas les messages), c’est plutôt d’être au plus près de ses transformations.
Ouvrages cités
BARTHES, Roland (1980), La Chambre claire, Paris Seuil-Gallimard
CHATEAU, Dominique et Jost, François (1979), Nouveau cinéma, nouvelle sémiologie, UGE, 10/18, repris par les éditions de Minuit, 1983.
GAUDREAULT, André (1988), Du littéraire au filmique. Système du récit, Méridiens Klincksieck.
GENETTE, Gérard (1987), Seuils, Seuil, coll. Poétique.
JOST, François (1979), « La sémiologie du cinéma remise en cause par l'analyse textuelle? », in Regards sur la sémiologie contemporaine, sous la direction de L. Roux et R. Odin, publication de l'université de Saint-Etienne, 212 p. (p. 43-51).
JOST, François (1992), Un Monde à notre image, Énonciation, Cinéma, Télévision, Méridiens-Klincksieck
JOST, François (2003), Realtà/finzione. L’Impero del falso, Milan, Castoro editrice (inédit en France)
JOST, François (2005), Comprendre la télévision, Armand Colin, coll. 128, 2e éd. : Comprendre la télévision et ses programmes, 2009 ; disponible en ebook.
LEJEUNE, Philippe (1973), Le Pacte autobiographique, Seuil, coll. Poétique.
METZ, Christian (1971), Langage et cinéma, Paris, Larousse, 1971.
METZ, Christian (1976), « L’étude sémiologique du langage : à quelle distance en sommes-nous d’une possibilité réelle de formalisation? », Communications, de Gruyter, vol. 2 issue 2, 1976, repris sur http://www.degruyter.com/dg/viewarticle/j$002fcomm.1976.2.issue-2$002fcomm.1976.2.2.187$002fcomm.1976.2.2.187.xml;jsessionid=5DBF1AD86049264890ED89C5A9A75385
METZ, Christian (1976), Le Signifiant imaginaire, Paris, U.G.E., 10/18
METZ, Christian (1991), l’Énonciation impersonnelle ou le site du film, Klincksieck
SPERBER, Dan et Wilson, Deirdre, La Pertinence, Paris, les Éditions de Minuit, 1989