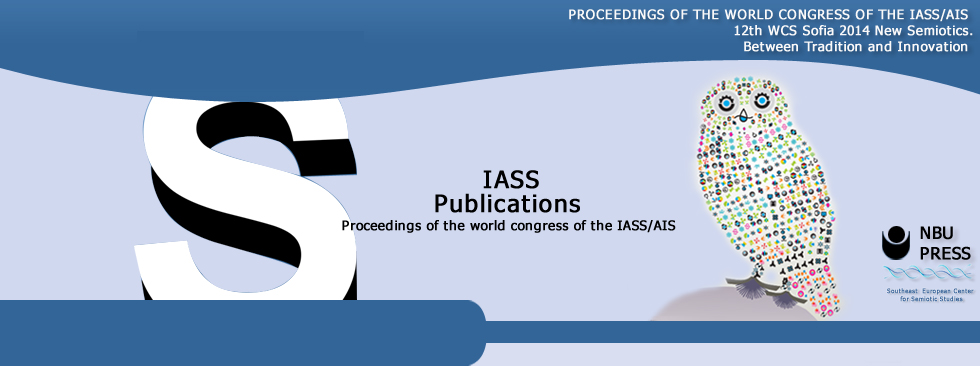LES MARQUES DE CONSOMMATION ET LES FORMES DE VIE SEMIOTIQUES QUELLES FONCTIONS, QUELLES RELATIONS, QUELLES DEFINITIONS ?
Abstract
A consumer society is characterized by specific discourses, objects and practices as well as semiotic entities hard to describe: brands. With the help of the semiotic concept of form of living, this paper precisely aims to lift the veil on what a brand is. Our reasoning will lead us to compare its symbolic logic to Barthes’ Mythologies and finally to define it as a device which promotes and naturalizes forms of living in the social space. Overall, this article may further the conceptualization of a brand management model of sociosemiotic inspiration.
Résumé
Une société de consommation se caractérise par des discours, des objets et des pratiques spécifiques, ainsi que par des instances sémiotiques difficilement qualifiables : les marques. En nous appuyant sur le concept sémiotique de la forme de vie, l’objectif de ce travail visera justement à lever le voile sur ce qu’est une marque de consommation. Le parcours que nous emprunterons nous amènera à rapprocher sa logique symbolique de celle des Mythologies de Barthes et finalement à la définir comme un dispositif de promotion et de naturalisation des formes de vie dans l’espace social. Plus globalement, cet article pourrait favoriser la conceptualisation d’un modèle de brand management d’inspiration sociosémiotique, et non plus uniquement sémionarratif comme c’est généralement le cas.
1. Introduction
« Une marque est un nom, un terme, un signe, un symbole, un dessin ou toute combinaison de ces éléments servant à identifier les biens ou services d’un vendeur ou d’un groupe de vendeurs et à les différencier des concurrents. » Cette définition de Kotler et Dubois (2004 : 455) sélectionnée parmi d’autres dans l’introduction de Branding management (2007 : 8) nous semble emblématique de la difficulté que rencontrent les spécialistes du marketing à définir précisément leur objet d’étude. Elle illustre plus largement, à notre avis, leur difficulté à appréhender les aspects sensibles et intangibles inhérents au phénomène des marques. Car si une marque est tout à la fois « un nom, un terme, un signe […] », elle ne l’est qu’à titre de dispositif sémiotique formalisé au plan du contenu.
Il s’agit en tout cas de notre hypothèse, celle que nous développerons dans ce travail en commençant par nous intéresser au sujet social et à la façon qu’il a de gérer son identité au quotidien, car c’est seulement en précisant d’abord ce qu’est une identité que nous pourrons en dernier lieu déterminer ce qu’est une marque d’un point de vue sociosémiotique. Au travers de l’étude de cas Abercrombie & Fitch, nous verrons en particulier que la fonction fondamentale d’une marque est d’optimiser et de pérenniser le positionnement social des sujets sociaux qui la consomment. Et finalement, en rapprochant cette logique de celle des Mythologies de Barthes (1959), nous montrerons que les marques ne font ni plus ni moins que promouvoir et naturaliser des formes de vie dans la sémiosphère. Cette dernière observation nous amènera alors à construire un schéma articulant ensemble le mythe et la forme de vie ainsi que réorganisant par la même occasion l’ordre des niveaux d’immanence du plan de l’expression tel que proposé par Fontanille (2008 : 34).
2. Questions d’identités
2.1. Une sphère de sens peuplée d’altérités
Dans Fondements pour une sémiotique existentielle, Tarasti décrit admirablement la façon dont le sens se construit à partir de la relation fondamentale liant le sujet à son environnement et rappelle que cette relation est loin d’être stable, car « l’une des facultés fondamentales de l’homme [est] sa capacité à transcender, […] à s’extraire en esprit de la deixis présente, à dépasser son ego hic et nunc » (2009 : 277). En effet, si l’environnement du sujet est évidemment d’abord sensible, puisqu’il est le lieu où se nouent sans cesse diverses tensions physiques et psychiques (sensations et émotions), il est également, et de façon tout aussi prépondérante, un environnement intelligible, fait de milliers de significations inscrites sur les objets et dans les textes culturels, eux-mêmes manipulés dans des pratiques déjà porteuses de sens. Pour cette raison, et à la suite de la proposition de Lotman (1999), nous devons envisager l’environnement dans lequel évolue l’esprit humain comme une sémiosphère. Et pour compléter cette prémisse, il nous paraît tout aussi important de souligner que dans cette sémiosphère le sujet n’est jamais seul ; il est toujours entouré d’autres sujets auxquels il peut tantôt s’identifier tantôt se distancier. Ces autres sujets, c’est ce que l’on appelle l’altérité, la figure générale à partir de laquelle le sujet façonne son identité.
2.2. Un sujet, mais plusieurs identités
En se basant sur les travaux de Prieto (1991), Basso Fossali explique dans La promozione dei valori (2008) qu’il existe deux types d’identités fondamentales : l’identité numérique et l’identité spécifique. Avec l’identité numérique, c’est d’abord la relation (physique ou biologique) qu’entretient une entité à elle-même qui est circonscrite : c’est l’identité qui fonde la relation entre un vieillard et l’enfant qu’il était 80 ans auparavant, ainsi qu’entre un papillon et une chenille. À l’inverse, l’identité spécifique met en relation plusieurs entités distinctes à partir de caractéristiques qualitatives communes. Cette identité, foncièrement culturelle, c’est celle qui fédère les individus appartenant aux mêmes communautés, pratiquant les mêmes activités, partageant les mêmes goûts...
Ainsi, au-delà du fait que « l’identità specifica è riproductible (copie, contraffazioni ecc.), mentre l’identità numerica è storica e non surrogabile » (Basso Fossali 2008 :111), on observe surtout que c’est autour de ces deux identités, indistinctement, que le sujet social gère son individuation dans la sémiosphère. Mais si l’individuation produite par l’identité numérique est effectivement non négociable (« non surrogabile »), il en va tout autrement pour l’identité spécifique qui offre au sujet la possibilité de se démarquer en investissant d’autres individualités, privées ou collectives (2008 : 112).
Maintenant, par rapport à cette identité spécifique, soyons plus précis. Il faut premièrement dire qu’elle peut être subie, à savoir que l’on peut, par exemple, paraître autoritaire ou jaloux, alors même que nous n’avons pas l’impression de l’être, encore moins la volonté de manifester ces traits de caractère. C’est une possibilité, mais la plupart du temps, cette identité est surtout visée comme lorsque, à dessein, nous faisons tout pour être élégants et polis, ou, à l’inverse, insolents et offensants. Dans ces circonstances, comme l’a proposé Ricoeur (1990), deux types de gestion de l’identité se font jour : soit on va chercher à cultiver ce pour quoi on est déjà reconnu (identité-idem) soit on va chercher à devenir ce que l’on n’est pas encore : ce à quoi on aspire (identité-ipsé). Une personne reconnue pour sa courtoisie et qui persévère dans cette bienséance renforcera son identité-idem. À l’opposé, une personne à qui aucune fibre artistique n’est reconnue, mais qui se sentirait profondément artiste, fera tout pour révéler son identité-ipsé, en commençant, par exemple, par peindre des toiles.
2.3. Les valeurs éthiques au fondement de l’identité spécifique
Les deux derniers exemples nous aident à voir que finalement une identité spécifique répond aux mêmes exigences structurelles que n’importe quelle instance sémiotique, à savoir qu’elle peut se laisser diviser en deux plans : un plan du contenu et un plan de l’expression.
Au plan de l’expression – qui, rappelons-le, est le plan des perceptions sensibles – l’identité spécifique du sujet se manifestera par des attitudes et plus généralement par un ethos ; l’ethos étant l’« ensemble des propriétés figuratives et sensibles formant un tout reconnaissable », la « signature d’un comportement éthique collectif ou individuel » (Fontanille 2008 : 266). Au plan du contenu – le plan des investissements sémantiques et thématiques, ainsi que des jugements axiologiques –, l’identité spécifique se définira par des valeurs éthiques, dont la combinaison formera une idéologie ; l’idéologie étant cette « articulation syntagmatique de valeurs […] qui n’étaient que virtuelles au niveau de l’axiologie » (Floch 1995 : 148).
Ces précisions faites, il faut maintenant expliquer un autre point, à savoir qu’une identité, et encore plus une identité spécifique, n’a de sens qu’à partir du moment où elle fait partie d’un système, en l’occurrence dès lors qu’elle est mise en rapport avec une doxa[1] (des principes, des mœurs, des bienséances sociales...[2]). En somme, c’est l’observation d’écarts entre la doxa sociale et l’ethos des individus qui fonde les identités spécifiques évoluant dans la sémiosphère. Ainsi, quand on entreprend d’analyser des identités spécifiques, c’est pour l’essentiel à une comparaison entre valeurs éthiques que nous procédons. Et si nous employons ici l’adjectif éthique, c’est parce qu’on peut dire que l’éthique est ce sens qui motive les actions pratiques et surtout la façon dont celles-ci sont conduites du point de vue comportemental.
[Au] plan du contenu, [l’éthique] est une axiologie spécifique à l’action, à son utilité, à la place de l’Autre, une axiologie projective, susceptible de capter le sens qui déborde l’action, c’est-à-dire une téléologie (cette téléologie se dédouble en « idéologie » – l’Idéal comme telos – et en « altérologie » – l’Autre comme telos – de l’action ») (Fontanille 2008 : 239).
Le tableau ci-dessous rend compte des différentes éthiques susceptibles d’être manifestées dans la sémiosphère. Il s’agit d’un carré sémiotique démultiplié que nous avons produit dans un précédent écrit (« Quelles valeurs éthiques pour les formes de vie promues par les marques de consommation ? ») à partir de l’axiologie de la consommation de Floch et des thèses sociosémiotiques développées par Landowski depuis la fin des années 1990.

Fig. 1 : Les valeurs et valorisations éthiques.
Pour aller à l’essentiel[3], nous dirons premièrement à propos de ce schéma que les valeurs éthiques peuvent être réparties dans quatre valorisations distinctes, chacune définissant un type de relation à l’autre spécifique : l’éthique corporelle explicite la manière d’être au monde du sujet, l’éthique positionnelle s’intéresse à son agir en commun, l’éthique situationnelle décrit sa façon de vivre la règle, enfin, l’éthique culturelle traduit l’attitude qu’il adopte pour construire du sens. Secondement, nous dirons qu’à l’intérieur d’une même valorisation, les valeurs s’excluent, mais qu’entre valorisations, elles se combinent. C’est grâce à ces deux propositions que nous avons ensuite pu dire, en conclusion de notre article, qu’une identité spécifique se compose, au niveau profond, de quatre valeurs articulées syntagmatiquement entre elles pour former, comme suggéré précédemment, une idéologie.
Afin de pouvoir embrayer avec la problématique des marques et des formes de vie, nous nous limiterons à décrire, dans le chapitre suivant, une seule de ces valeurs (la licence), tout en rappelant qu’un système idéologique n’est véritablement complet, et ne fait véritablement sens, que lorsque toutes les valeurs éthiques sont prises en compte.
3. La licence productrice de sens
3.1. Une valeur paradoxale
Comme c’est généralement le cas avec les notions dont le sémantisme est intrinsèquement éthique, la licence est diversement appréciée et valorisée. La définition qu’en propose le Trésor de la langue française peut expliquer ces jugements ambivalents, puisque la licence y est décrite comme une « liberté généralement excessive que se donne une personne, parfois un groupe de personnes.[4] » En effet, le caractère excessif de la licence peut être envisagé comme le pivot tensif qui fait basculer la notion vers une évaluation tantôt positive (la libération) tantôt négative (le libertinage).
En 2013, Landowski avait en partie défini ce qu’est la licence au travers d’une autre notion, l’insolence. Malheureusement, en s’intéressant à l’insolence, l’auteur n’avait décrit que le versant négatif de la licence ainsi que l’attestent ces différents extraits : « [l’insolence, c’est] ne pas manifester de respect (ou, plus grave, manifester de l’irrespect) à l’égard de qui (ou de ce qui) est considéré comme en étant digne », elle est une « forme vicieuse de l’irrespect », une « simple excentricité, acte de provocation gratuite, recherche d’une « originalité » et d’un « insolite » qui ne mènent à rien […] tout au plus à épater à bon compte le bourgeois ou à scandaliser l’académie, l’insolence vise la gloire » (2013 : n.p.).
Cette connotation dépréciative se retrouve également dans l’une des définitions de la licence, lorsqu’elle est comparée à un « état de dérèglement moral dans lequel vit une personne ou une collectivité » (Trésor de la langue française). Néanmoins, à l’inverse de l’insolence, la licence peut aussi être socialement tolérée, voire admirée : c’est le cas lorsqu’elle est associée à une inventivité, certes gratuite, souvent idiosyncrasique et généralement irréfléchie, mais tout de même productrice d’un sens. La licence poétiquecaractérise assez bien cette attitude dont la valeur ne réside que par les apports stylistiques qu’elle permet, à savoir créer un sens qui ne vaut que par sa vanité, sa singularité et son esthétique. A partir de là, c’est donc plus généralement la doxa qui va faire pencher la licence vers une insolence condamnable ou une performance admirable.
3.2. De différentes manières d’exprimer la licence
Comme nous l’avons dit, une attitude éthique peut se cultiver (identité-idem) ou se poursuivre (identité-ipsé). On peut donc dire qu’elle est vécue par choix, mais de façon tout aussi vraie on doit dire qu’elle est vécue malgré soi, en ce sens que le jugement de cet ethos par une altérité est toujours susceptible de s’écarter de l’intention première du sujet qui l’adopte. Cette dialectique entre production et réception est constante.
Enfin, il est aussi important de dire que, en principe, une éthique est une inclination naturelle – un tropisme – et que, en ce sens, elle ne résulte pas d’une posture. On pourra alors objecter qu’un individu timide qui désirerait montrer davantage d’assurance est obligatoirement dans le simulacre. Mais il n’en est rien, car c’est précisément parce que quelque chose le pousse à agir, en l’occurrence à devenir autre (identité-ipsé), qu’il ne tient pas de posture. Adopter une posture, ce n’est en fait rien d’autre qu’exprimer une nécessité éthique profonde.
En ayant cela en tête, nous pouvons à présent nous demander quels sont les différents moyens à notre disposition pour exprimer une identité, en l’occurrence une identité véhiculant une dimension licencieuse. Tout d’abord, pour l’avoir vécu, vu ou entendu dans la sémiosphère, on saura que l’on peut manifester une identité licencieuse verbalement, par exemple en étant rustre, impoli ou intrusif. Certains gestes ainsi que d’autres attitudes corporelles pourront aussi participer de cette licence, comme le doigt d’honneur, le fait de roter, de manger la bouche ouverte…
À côté de ces expressions puisant du côté des ressources corporelles, on aura aussi appris qu’il est possible de manifester une identité licencieuse grâce à la médiation, dans certaines situations et en présence de certains individus, d’artefacts spécifiques : le maquillage excessif au travail pour les femmes qui exerceraient une profession sociale auprès de personnes vivant dans la précarité ; la cigarette fumée dans les préaux d’écoles pour les professeurs et les surveillants d’établissements ; les lunettes de soleil en boîte de nuit pour les fêtards.
3.3. Un Objet de valeur aux multiples facettes
La présentation de ces deux langages licencieux (le corps et les artefacts) nous amène à faire l’observation et la conclusion suivantes : dans la sémiosphère, le sujet social fait l’expérience de manifestations licencieuses diverses et variées, ce qui a pour conséquence d’instituer la /licence/ comme un Objet de valeur, au sens de la sémiotique narrative. Et, en fait, elle le devient à double titre.
D’abord, l’Objet de valeur /licence/ est ce que la sémiosphère comme Destinateur communique au sujet social, ici dans le rôle du Destinataire. Dans cette conjoncture, le sujet est simple observateur des modes d’expression licencieux, mais aussi Sujet narratif potentiel dans la mesure où, s’il le décide, il peut chercher à se conjoindre avec ces manifestations pour devenir ou demeurer lui-même licencieux. Deux types de quêtes narratives se présentent alors à lui : soit une quête visant l’acquisition d’un artefact licencieux (l’appréhension) soit une quête visant l’apprentissage d’une manière d’être licencieuse (l’imitation). Comme théorisé dans un précédent article (« La praxis narrativecomme modèle sémiotique pour interpréter les pratiques sociales »), cette conjoncture, dite délibérative[5], se caractérise par la production d’un faire-savoir conduisant à unfaire-vouloir.
Ensuite, si l’on part du principe que le sujet social est parvenu à s’approprier, puis à vivre la /licence/ dans une pratique, on verra qu’une nouvelle fois la licence devient Objet de valeur. Mais cette fois-ci, les rôles s’inversent, puisque c’est le sujet social qui devient le Destinateur et la sémiosphère qui devient le Destinataire (en sa qualité de figure englobant toutes les altérités). Dans cette conjoncture expressive[6], la /licence/ est une seconde fois Objet de valeur.
À travers l’exposition de ces deux moments narratifs, ce que nous souhaitions montrer, c’est que la /licence/ comme valeur éthique peut s’incarner dans divers types d’actants. La catégorie des « figures actantielles » proposée par Fontanille dans Séma et Soma (2004 : 115) nous aidera à y voir plus clair :

Fig. 2 : Les figures actantielles selon Fontanille.
Nous avons précédemment montré que la licence pouvait s’incarner dans des formes (actants ayant une masse, mais aucune énergie propre) comme des lunettes de soleil ou une cigarette. Nous avons aussi indirectement montré qu’un acteur, c’est-à-dire un individu (actant doté d’une masse et d’une énergie propre), pouvait aussi exprimer à lui seul la licence. Désormais, nous pouvons donc dire que la licence, et plus largement n’importe quelle valeur éthique, n’a pas de consistance prédéterminée. Pour la sémiotique, ce constat est une lapalissade toutefois, puisque, rappelons-le, une valeur éthique se situe toujours au plan du contenu, c’est-à-dire qu’elle ne se définit pas en rapport à sa masse ou à son expression, mais par rapport à son intensité, à l’éclat qu’elle dégage. De fait, la véritable question qui se pose à présent, en rapport au schéma de Fontanille, est de savoir si une valeur éthique est une force ou une aura.
4. La marque dans tous ses états
4.1. De l’aura à la force, et vice-versa
Imaginons deux amis discutant tranquillement à la terrasse d’un café. En les observant superficiellement aucun indice ne nous paraîtra marquer, chez l’un comme chez l’autre, une identité particulière, si ce n’est une certaine forme de normalité. Mais si l’on décidait de procéder à une analyse plus minutieuse, nous verrions une particularité vestimentaire caractérisant chacun des amis. Nous découvririons sur le pull du premier l’inscription « Abercrombie & Fitch » et sur le sweater du second un logo – au niveau de la poitrine, côté cœur – dessinant la silhouette d’un élan.
À partir de là, deux cas de figure sont à envisager : soit la marque Abercrombie & Fitch nous est familière, soit elle nous est inconnue. Dans le cas où nous connaîtrions la marque et la reconnaîtrions sur les habits des deux compères, les valeurs qu’elle promeut seraient en principe manifestes. C'est-à-dire que l’expérience sémiotique de ces manifestations, à savoir la vision du nom et du logo de l’élan, devrait en principe activer les valeurs éthiques que l’on associe conventionnellement à la marque et que l’on peut formaliser ainsi : {/maintien/, /distinction/, /narcissisme/, /licence/}[7]. Dans cette situation, nous pourrions alors dire que la licence, mais plus largement l’ensemble de l’idéologie ici décrite, tient lieu de force. Parce qu’elle parvient à attirer l’attention, par le biais d’une médiation sensible comme un logo, la valeur licencieuse peut en effet être décrite comme un actant certes sans masse, mais qui dégage néanmoins une véritable énergie, une vraie force d’attraction, qui non seulement marque les sujets sociaux qui la portent, mais également qui interpelle par son éclat les altérités alentour.
À l’inverse, si l’on s’était mis dans la peau d’un observateur qui ne connaissait pas Abercrombie & Fitch, la valeur licencieuse de la marque serait demeurée latente, pure potentialité non actualisée. Ici, c’est l’aura comme actant sans masse ni énergie qui aurait le mieux décrit la valeur /licence/. Au final, on voit donc surtout qu’une valeur éthique (ou une idéologie) est toujours une aura sauf lorsqu’elle est saisie dans une pratique, auquel cas elle devient force d’assomption.
4.2. Le dispositif économique de la marque
Voyons à présent ce que la marque a apporté aux deux amis. D’abord, par l’intermédiaire de signes propres, elle leur a permis d’économiser des efforts. En effet, il est évident que vouloir manifester une éthique licencieuse autrement qu’à travers des artefacts ou des insignes présage une entreprise particulièrement épuisante : il s’agirait de parler et de se comporter de façon provocante, et ce, constamment. En portant des habits de marque, l’effort devient en revanche nettement moindre et l’effet peut être tout aussi, voire plus fort. Ainsi, d’un point de vue sociosémiotique, on peut déjà dire qu’une marque est un dispositif économique et expressif qui vise à marquer un positionnement social. Et c’est nécessairement en mettant en circulation des produits, sortes de marqueurs identitaires manifestes, que l’entreprise propriétaire de la marque rend cela possible.
Mais il faut tout de suite préciser une chose : le produit en tant que tel ne suffit généralement pas à caractériser une marque[8]. En effet, il est peu probable qu’un observateur qui connaîtrait pourtant la marque à l’élan soit capable de reconnaître un sweater Abercrombie & Fitch dépouillé de tout signe extérieur (nom ou logo). Outre le nom, on voit ainsi que c’est surtout le logo sur le produit qui permet de la façon la plus économique – une fois de plus – de révéler une marque et in fine une idéologie. Mais le problème qui se pose encore ici, c’est qu’un logo est un signe arbitraire qui, en principe, n’entretient aucune relation motivée avec les valeurs promues par la marque : en d’autres mots, une idéologie ne réfère à aucune réalité matériellement déterminée.
Par conséquent, pour les entreprises et les agences de communication qui les conseillent, promouvoir une marque, c’est prioritairement élaborer un faire-savoir : d’abordfaire-savoir que la marque est associée à telle idéologie, ensuite faire-savoir que le logo est associé à cette marque. En ce sens, la communication publicitaire de marque vise davantage la diffusion d’associations qu’une incitation à l’achat. Aussi, la réussite d’une communication de marque devrait-elle toujours se mesurer à la lumière des scores de visibilité et de notoriété réalisés non seulement auprès du public cible, mais surtout auprès de l’ensemble de la population, car c’est tout le corps social qui participe, par ses jugements et ses opinions, à façonner chacune des idéologies qui traversent la sémiosphère.
Il est alors aussi nécessaire d’observer que si c’est bien l’entreprise qui crée la marque et qui, originellement, choisit son idéologie, ce n’est ensuite plus elle qui décide seule du positionnement que la marque exprime. Une fois que la marque est installée et manipulée dans la sémiosphère, l’opinion publique et les médias participent aussi, par leurs discours, à renforcer ou modifier l’idéologie initialement fondée par l’entreprise. C’est donc pour éviter des écarts de jugements indésirables que l’entreprise doit continuellement communiquer sur sa marque, de la façon la plus cohérente et en sélectionnant dans sa communication les codes et les topoi qui expliciteront de la manière la moins ambiguë possible les valeurs éthiques qu’elle désire promouvoir.
4.3. Mythique par nature
Au terme de ce travail, nous pouvons dire que la marque est un dispositif sémiotique dont le but est d’exprimer de la façon la plus économique possible une forme de vie[9]. Cette définition résume les différents points abordés jusqu’à présent, mais surtout laisse entrevoir la raison pour laquelle la marque est un phénomène profondément marchand. En effet, la marque permet au sujet social d’épargner du temps et de l’énergie ; un temps et une énergie qu’il aurait été contraint de gaspiller s’il avait voulu exprimer sa forme de vie ou son identité visée autrement qu’avec une marque. Plus particulièrement, on voit maintenant que c’est en s’appuyant sur l’efficacité des trois fondamentaux de la marque – le produit, le logo et la communication – que l’entreprise parvient à mâcher le travail d’expressivité existentielle au sujet social. Mais évidemment ce travail a un coût en temps, en argent et en énergie pour l’entreprise et ce serait dès lors ces différents investissements que le sujet-consommateur gratifierait au moment de l’achat d’une marque[10].
Par ce travail constant de diffusion d’associations symboliques, l’entreprise en vient finalement à élever la marque au rang de mythe. Et si nous disons cela, c’est parce que, comme le glosait Barthes à propos des différents mythes contemporains (1959), la marque naturalise la relation (la sémiose) entre l’idéologie, le logo et les produits que l’entreprise a choisis pour elle. À force de campagnes de communication, l’entreprise transforme en effet des associations arbitraires (fondées sur une histoire) en systèmes motivés (laissant croire à des relations naturelles). Les deux extraits suivants, tirés des Mythologies rendent compte de cette « prestidigitation » (1959 : 217) :
Là où il n’y a qu’une équivalence, il [le mythe] voit une sorte de procès causal : le signifiant et le signifié ont, à ses yeux, des rapports de nature. […] tout système sémiologique est un système de valeurs ; or le consommateur du mythe prend la signification comme un système de faits (1959 : 204).
En passant de l’histoire à la nature, il [le mythe] fait une économie : il abolit la complexité des actes humains, leur donne la simplicité des essences, il supprime toute dialectique, toute remontée au-delà du visible immédiat, il organise un monde sans contradictions parce que sans profondeur, un monde étalé dans l’évidence (1959 : 217).
5. Conclusion
Nous avons parlé d’identités, d’idéologies et de valeurs éthiques sans nous arrêter sur la notion de forme de vie. À dessein, nous voulions d’abord présenter certains de ces termes pour ensuite mieux circonscrire ce dernier concept.
Comme l’ont très bien fait remarquer Fontanille (2008) et Basso Fossali (2012), les formes de vie sont les instances sémiotiques les plus globalisantes d’une culture. Ce sont elles qui « imposent des orientations sur plusieurs catégories de contenus (et donc sur plusieurs niveaux du parcours génératif de la signification), ainsi que sur plusieurs types expressifs (et donc sur plusieurs plans d’immanence de l’expression) » (Fontanille 2012 : n.p.). Cette omnipuissance et -présence de la forme de vie pose plus profondément la question de son statut sémiotique ; soit comme instance du plan de l’expression comme le propose Fontanille avec ses « plans d’immanence de l’expression » (2008 : 34), soit comme instance du plan du contenu comme le suggère paradoxalement aussi Fontanille de façon cependant moins explicite (2008 : 33). Cette ambivalence est aussi discutée par Badir qui estime que l’« on est en droit de se demander si leur pertinence [aux formes de vie] ne relève pas davantage de ce plan [le plan du contenu] que du plan de l’expression proprement dit » (2009) ainsi que par Basso Fossali qui « doute qu’on puisse retrouver enfin une forme et pas au contraire une force d’assomption pure [avec la forme de vie] » (2012).
Les observations que nous avons faites sur la capacité des valeurs éthiques à investir n’importe quelle figure actantielle (actant, acteur, aura, force) nous semblent pouvoir éclairer le débat, car, en fait, ce ne sont pas tant ces valeurs éthiques qui prennent en charge ces figures actantielles – comme nous l’avons postulé dans un premier temps –, mais bien plutôt la forme de vie qui les subsume. Le schéma ci-dessous rend compte de cette hypothèse où c’est la forme de vie qui régit l’ensemble du dispositif sémiotique. L’arborescence que nous utilisons est empruntée à Floch (2002 : 106) qui s’était lui-même inspiré du schématisme de Hjelmslev. En outre, au plan de l’expression (système dénotatif), nous avons ajouté les niveaux d’immanence du plan de l’expression de Fontanille[11] (2008 : 34) tels que nous pensons qu’ils s’articulent dans cet ensemble.

Fig. 3 : La modélisation de la forme de vie.
Comme configuration où une idéologie est mythifiée sur l’ensemble des niveaux d’immanence du plan de l’expression[12], la forme de vie peut également être définie métonymiquement selon différentes perspectives. Du point de vue de l’idéologie, elle sera une aura de valeurs éthiques flottant dans la sémiosphère. Du point de vue du mythe, elle sera une force d’assomption éthique. Enfin, pour le sujet social qui la vit ou la vise, la forme de vie représentera une « enveloppe expérientielle » (Basso Fossali 2012 : 12) qui stabilise et pérennise nécessairement son identité, et qui peut être saisie ou cultivée plus ou moins facilement.
Bibliographie
BADIR, Sémir. 2009. La production de la sémiosis. Une mise au point théorique. Actes sémiotiques 112. http://epublications.unilim.fr/revues/as/3335 (consulté le 26 décembre 2014).
BASSO Fossali, Pierluigi. 2008. La promozione dei valori. Semiotica della comunicazione e dei consumi. Milano : Franco Angeli.
BASSO Fossali, Pierluigi. 2012. Possibilisation, disproportion, interpénétration : trois perspectives pour enquêter sur la productivité de la notion de forme de vie en sémiotique.Actes sémiotiques 115. http://revues.unilim.fr/nas/document.php?id=4138 (consulté le 26 décembre 2014).
FLOCH, Jean-Marie. 1990. Sémiotique, marketing et communication. Sous les signes les stratégies. Paris : PUF.
FLOCH, Jean-Marie. 1995. Identités visuelles. Paris : PUF.
FLOCH, Jean-Marie. 2002. Introduction. Quelques concepts fondamentaux en sémiotique générale. Dans Anne Hénault, Questions de sémiotique, 103–119. Paris : PUF.
FONTANILLE, Jacques. 1993. Les formes de vie. Présentation. RSSI 13(1–2). 5–12.
FONTANILLE, Jacques. 2004. Soma et Séma. Figures du corps. Paris : Maisonneuvre & Larose.
FONTANILLE, Jacques. 2008. Pratiques sémiotiques, Paris : PUF.
FONTANILLE, Jacques. 2012. Julien Fournié : les saisons de la mode. Formes de vie et passions du corps. Actes sémiotiques 115. http://epublications.unilim.fr/revues/as/2650 (consulté le 26 décembre 2014).
KOTLER, Philip & Bernard Dubois, 2004. Marketing Management. 11e éd. Paris : Pearson Education.
LANDOWSKI, Eric. 1997. Présences de l’autre. Essais de socio-sémiotique II. Paris : PUF.
LANDOWSKI, Eric. 2013. Plaidoyer pour l’impertinence. Actes sémiotiques 116. http://epublications.unilim.fr/revues/as/1450 (consulté le 26 décembre 2014).
LEWI, Georges & Jérôme Lacœuillhe. 2007. Branding management. La marque, de l’idée à l’action. 2e éd. Paris : Pearson Education.
LOTMAN, Iouri. 1999 [1969]. La sémiosphère. Trad. Anka Ledenko. Limoges : PULIM.
PERUSSET, Alain. À paraître. De l’émotion gustative à la forme de vie. Le parcours identitaire d’une marque de restauration rapide.
PERUSSET, Alain. À paraître. La praxis narrative comme modèle sémiotique pour interpréter les pratiques sociales. Mise à jour du schéma narratif de Greimas.
PERUSSET, Alain. À paraître. Quelles valeurs éthiques pour les formes de vie promues par les marques de consommation ? Développement autour l’axiologie des valeurs de consommation de Jean-Marie Floch.
PRIETO, Luis Jorge. 1991. Saggi di semiotica. II – Sull’arte e sul soggetto. Parma : Pratiche.
RICŒUR, Paul. 1990. Soi-même comme un autre. Paris : Seuil.
TARASTI, Eero. 2009 [2000]. Fondements de la sémiotique existentielle. Trad. Jean-Laurent Csinidis. Paris : L’Harmattan.
[1] Cette exigence n’en est en fait pas vraiment une, car ce lien existe déjà : un sujet évolue nécessairement dans une sémiosphère déjà normée et codifiée.
[2] En règle générale, la doxa est intériorisée. Elle se manifeste dans des discours institutionnalisés (lois, préceptes religieux…), mais est aussi très souvent tacite (habitudes, traitements médiatiques…).
[3] Les étapes du développement de ce système éthique font l’objet de notre article « Quelles valeurs éthiques pour les formes de vie promues par les marques de consommation ? ».
[4] Trésor de la langue française. (2014) http://www.cnrtl.fr/definition/licence (consulté le 26 décembre 2014).
[5] La conjoncture délibérative correspondrait dans le cadre de la sémiotique des cultures au programme de la manipulation de la sémiotique narrative.
[6] La conjoncture expressive serait la reformulation sociosémiotique du programme narratif de la sanction.
[7] Nous proposons ces valeurs éthiques sous bénéfice d’inventaire, car pour pouvoir véritablement asserter l’idéologie suggérée, il faudrait pouvoir s’appuyer sur des études qualitatives et quantitatives.
[8] Il faut bien avouer qu’il existe quand même des designs, des packagings et des expériences qui caractérisent à eux seuls une marque. Pensons à la forme de la bouteille Coca-Cola ou à la fragrance d’un Chanel N°5.
[9] Dans cette définition, nous aurions pu substituer le concept d’identité, déjà glosé, à celui de forme de vie que nous ne définirons qu’en conclusion. Mais si nous avons choisi de déjà introduire la forme de vie, c’est parce que l’identité est une dynamique, un processus, qui n’est analysable qui si nous la réduisons, la stabilisons, dans une forme. En l’espèce, la forme de vie serait cette identité formalisée.
[10] Précisons encore que c’est sur les enjeux éthiques de la marque que nous nous penchons, car il est bien clair qu’un consommateur peut acheter une marque uniquement pour tirer profit des performances fonctionnelles du produit.
[11] Les raisons qui nous amènent à intégrer les niveaux d’immanence du plan de l’expression dans cette structure sémiotique sont discutées dans notre article « De l’émotion gustative à la forme de vie ».
[12] Nous nous inspirons de la définition inaugurale des formes de vie formulée par Fontanille en 1993 dans laquelle celles-ci étaient assimilées à des « configurations où une "philosophie de la vie" s’exprimerait par une déformation cohérente de l’ensemble des structures définissant un projet de vie » (1993 : 5).