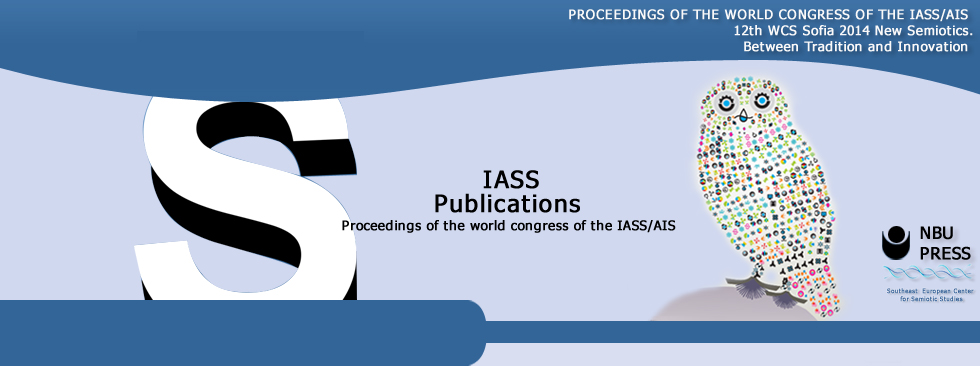ÉNONCIATION AUDIOVISUELLE : FAUT-IL RENIER CHRISTIAN METZ?
Université de Limoges, France
sylvie.perineau@unilim.fr
Résumé
Le nom de Christian Metz est indissociablement lié à l’analyse sémiotique du film (le cinéma comme langage et sa spécificité ; les opérations fondamentales de condensation et déplacement ; la grande syntagmatique, etc.). Cette présence forte – pour ne pas dire cette aura initiatrice – de Christian Metz, a clairement un effet inhibant, d’autant qu’il a échoué dans sa tentative pour théoriser un/le système filmique comme tel. La question se pose alors : pourquoi essayer à notre tour ? Or, c’est la nécessité qui fait droit : il nous faut reprendre là où Metz s’est arrêté, faute de quoi, il n’existe pas de sémiotique filmique ou audiovisuelle en tant que telle mais des contextualisations de problèmes sémiotiques dans le terrain de l’audiovisuel (cinéma, télévision, vidéo, etc.).
En me situant par rapport l’aspiration de Gilles Deleuze (1985) à une sémiotique pure de « l’énonçable » et avec le renfort théorique de Jean-François Bordron sur l’effectuation (2003), je propose de travailler l’énonciation comme n’étant ni l’activité globale ni même les traces de son passage mais véritablement une prise de la situation filmique, c’est-à-dire un cadre d’existence et d’actions offerts aux spectateurs.
Le nom de Christian Metz est indissociablement lié à l’analyse sémiotique du film (le cinéma comme langage et sa spécificité ; les opérations fondamentales de condensation et déplacement ; la grande syntagmatique, etc.). Cette présence forte - pour ne pas dire cette aura initiatrice - de C. Metz, a clairement un effet inhibant, d’autant qu’il a échoué dans sa tentative pour théoriser un/le système filmique comme tel. La question se pose alors : pourquoi essayer à notre tour ? Or, c’est la nécessité qui fait droit : il nous faut reprendre là où C. Metz s’est arrêté, faute de quoi, il n’existe pas de sémiotique filmique ou audiovisuelle en tant que telle mais des contextualisations de problèmes sémiotiques dans le terrain de l’audiovisuel (cinéma, télévision, vidéo, etc.).
Comme le chantier est ouvert et qu’il faut bien commencer, j’ai choisi de suivre ce qui témoigne de préoccupations actuelles et qui est également un serpent de mer chez les théoriciens (pour n’en citer que quelques-uns : Laffay 1947/1964 ; Branigan 1984 ; Casetti 1990 ; Gunning 1990 ; Jost 1992 ; Odin 2000 ; Boillat 2001, etc.) : l’énonciation audiovisuelle. Or, dans L’Énonciation impersonnelle ou le site du film (1991) le rôle excessif dévolu à la « machine cinéma » et la mutabilité des figures de l’adresse constituent des obstacles à une énonciation comme partie intégrante d’un langage audiovisuel. D’aucuns se sont positionnés par rapport à une théorie globale de l’énonciation, parfois dans des directions tout à fait inverses. Ainsi, du côté de la deixis, là où F. Jost (1997 ; 1998 ; 1999 ; 2001/2003) ou R. Odin (1988) nous permettent de distinguer entre Je-origine-réel et Je-origine-fictif, C. Paolucci (2014) au contraire offre de dépersonnaliser l’énonciation comme de désindividualiser la subjectivité.
Pourtant, entre la version représentationaliste de l’énonciation et la version autoréférentielle du dispositif énonciatif qui se met en scène, entre la conception déictique ou la conception impersonnelle, il existe, me semble-t-il sinon une troisième version, ou du moins des espaces vacants et qui satisfont à un impératif de spécificité propre tout en permettant d’inscrire l’audiovisuel comme langage (Hjelmslev 1968–1971). À cet égard, je propose de m’appuyer sur deux éléments clés : la spécificité de la médiation comme de la représentation audiovisuelle ; l’effectuation nécessaire par et pour le spectateur. En effet, ni l’activité globale de l’énonciation en acte, présupposée, ni même les traces en tant qu’elles sont censées renvoyer à cette énonciation, ne permettent ou ne suffisent pour envisager ce que les spectateurs font avec l’énonciation.
En me situant par rapport l’aspiration de G. Deleuze (1985) à une sémiotique pure de « l’énonçable » et avec le renfort théorique de J.-F. Bordron sur l’effectuation (2003), je propose de travailler l’énonciation comme n’étant ni l’activité globale ni même les traces de son passage mais véritablement une prise de la situation filmique, c’est-à-dire un cadre d’existence et d’actions offerts aux spectateurs.
1. Lire les propositions de L’Énonciation impersonnelle (C. Metz)
1.1. Comme impulsion sémiologique majeure
Qu’il faille continuer à travailler l’énonciation, C. Metz s’en déclare « partisan » (1991 : 18). En ligne d’horizon, Metz lui-même espère que « l’exemple du cinéma (…) nous invite à élargir notre idée de l’énonciation » jusqu’à peut-être « rétroagir sur la sémiologie et la linguistique générale ».
Mais dès qu’il pose la question de l’instance énonciatrice, il en soulève le problème majeur : « l’énonciation a volontiers quelque chose d’anthropoïde » (1991 : 12). La solution qu’il propose assez tôt dans l’ouvrage (1991 : 19) : « concevoir un appareil énonciatif qui ne soit pas essentiellement déictique (donc anthropomorphique), pas personnel (comme les pronoms que l’on appelle ainsi), et qui n’imite pas de trop près tel ou tel dispositif linguistique ».
La non-reconduction du couple anthropomorphe (1991 : 26) l’amène à conclure que « l’énonciateur c’est le film, le film en tant que foyer, agissant comme tel, orienté comme tel, le film comme activité ». Ce sera donc l’énonciation dite impersonnelle, sans les personnes mais pas sans les divers signes énonciatifs et leurs glissements de niveaux. Au contraire même, renvoyant à F. Jost et à J.-P. Simon, C. Metz (1991 : 77) indique que le « cinéma pratique l’emploi énonciatif de n’importe quel signe » au contraire de la langue « qui a des signes énonciatifs spécialisés (déictiques) ». Plus fermement dans son dernier chapitre, il précise que « l’énonciation est coextensive à tout l’énoncé » (1991 : 210). Telle est donc la solution trouvée lorsque ce n’est pas le fait manifeste d’instances.
1.2. Pour poser le cadre théorique
Tout en se présentant comme une réponse, l’ouvrage ne résout pas vraiment les problèmes théoriques et en pose d’autres, autant de méthode que de théorie. Précisons que L’Énonciation impersonnelle ou le site du film a fait l’objet d’au moins deux discussions sémiotiques serrées avec l’ouvrage Un monde à notre image. Énonciation, cinéma, télévision de F. Jost (1992) et l’article de J. Fontanille « Des simulacres de l’énonciation à la praxis énonciative » (1994).
1.2.1. Adéquation
Le problème d’adéquation est lié à l’importation de la théorie de l’énonciation hors du domaine linguistique. C. Metz s’en fait lui-même l’objection. Bien d’autres, comme A. Gaudreault ou D. Bordwell, évoquent une métaphore et un transfert inadéquat. Effectivement, ceci suppose d’élargir la perspective et de considérer que nous avons affaire avec les films, les émissions de télévision ou les vidéos à des faits de langage. Mais le problème est également cette importation se réalise dans un contexte mass médiatique où les conditions de communication sont multiples. Pourtant, dans le dictionnaire Sémiotique, l’article de M. Hammad (1986 : 75) indique qu’« écrire la signification d’un énoncé, c’est donc décrire son énonciation, c’est-à-dire proposer une représentation du surgissement de cet énoncé dans un contexte donné ». Par conséquent une discipline qui s’intéresse à la production de la signification rencontre nécessairement la question de l’énonciation. Le tout est d’y adapter les théories préexistantes. À part le regard-caméra qui est véritablement sacré comme « 2ème personne optique » (1991 : 67) C. Metz n’effectue pas vraiment de transposition de l’origo. Il traite en fait de l’énonciation comme thématisation singulière ou comme un effet illocutoire dans le cadre d’interpellations qui jouent sur les niveaux diégétiques et extradiégétique. Soulignons aussi que C. Metz se concentre finalement sur la fiction, alors que le Je-ici-maintenant peut réellement intervenir pour les énoncés non fictionnels, à la télévision par exemple, sous condition d’interlocution et de concomitance avec le temps spectatoriel.
Quelle est l’incidence du rejet de l’anthropomorphisation sur la réversibilité ? C. Metz signale lui-même (1991 : 13) que « les instances d’incarnation ne correspondent pas aux postes énonciatifs de façon régulièrement homologique. Ainsi, le spectateur […] qu’on attendrait tout uniment du côté de la cible, occupe à la fois le foyer dans la mesure où il est identifié à la caméra, et la cible pour autant que le film le regarde ».
Or, C. Metz opère ici deux rabattements. Le premier consiste à créer une symétrie de miroir entre les situations de production et les modes de réception. Pourtant, si le dispositif d’enregistrement puis de visionnement du cinéma a été réversible, cette condition technique initiale par la suite dépassée ne peut suffire à conditionner l’acte spectatoriel en général comme double position de visée et de source. Le second rabattement consiste à hypostasier la dite situation d’énonciation pour comprendre l’énonciation. Or, sur ce point, il faut faire une distinction claire entre les possibilités du contexte cinématographique et celle du contexte télévisuel. Dans le contexte télévisuel, la situation d’énonciation n’entraîne de co-présence effective, exactement une concomitance, entre tous les partenaires que dans le cas de direct diffusé immédiatement.
Dans tous les autres cas, si nous parlons de déictisation des énoncés, c’est sur le mode de l’effet, comme rhétorique, car la co-présence n’est pas une appartenance au même régime d’existence que celui entraîné par toute autre situation énonciative. Ainsi, le spectateur peut être comme identifié à la caméra, c’est-à-dire à une instance originelle qui peut d’ailleurs ne pas se laisser différencier de la première instance déléguée. Par exemple, si l’incipit de The Tree of life (T. Malick) construit une situation d’adresse, c’est pour proposer au spectateur - sans garantie - une place telle que celle qu’occuperait un interlocuteur.
Le second déplacement concerne la réflexivité. De prime abord, rien ne contrecarre l’exercice énonciatif à condition de considérer comme C. Metz (1991 : 19) que « lorsque l’énonciation se marque dans l’énoncé, au cinéma, ce n’est pas, ou pas principalement, par des empreintes déictiques, mais par des constructions réflexives ».
Or, la réflexivité n’est pas continue (certes, les déictiques pas plus) et surtout pas englobante même si la tentation est grande de lui conférer une dimension absolue. Ainsi, C. Metz affirme-t-il (1991 : 30) : « L’énonciation filmique est toujours une énonciation sur le film. Métadiscursive plus que déictique, elle ne nous renseigne pas sur quelque hors texte, mais sur un texte qui porte en lui-même son foyer et sa visée ». Et C. Metz d’évoquer volontiers : « cette sorte de dédoublement de l’énoncé » aussi appelé « repli » (1991 : 20) « qui consiste à être à la fois […] dehors et dedans… Or, comme va devoir le souligner C. Metz lui-même en renvoyant à J.-P. Simon, « le film, même émancipé, ne saurait faire coïncider en lui le produit et la production (1991 : 86), mais seulement, en un geste mimétique, le produit et la mise en abyme de son procès ». Donc, on se retrouve de nouveau avec des effets de récursivité ou de commentaire, c’est-à-dire avec des procédés rhétoriques dont nous serions bien en peine de déterminer s’ils constituent le film comme tel et le configurent ou s’ils en exhibent les procédés.
1.2.2. Observation, donc systématisation
Certes, la distinction entre ce qui pointe vers l’énonciation en acte, en prise avec la situation d’énonciation, et ce qui appartient à une représentation n’est pas toujours facile. En fait, toute la difficulté, nous dit C. Metz, est d’identifier ce qui vaut comme des procédés « plus nettement discursifs que d’autres figures ». La difficulté d’objectivation augmente lorsque la forme du dit empêche de désintriquer le dit du dire ou que l’on cherche la signification d’une séquence tout en y décelant une subjectivation flottante.
En outre, on s’aperçoit un peu nécessairement mais aussi caricaturalement que C. Metz verse au rang des procédés pouvant valoir comme marqueurs discursifs, ceux qui se voient tels les fondus ou les volets. Mais alors, quid des traces énonciatives imperceptibles ou neutres ?
1.2.3. Simplification
Disons que C. Metz, tout en cherchant vraiment les conditions de possibilité d’une énonciation comme système général, reconduit les problèmes lorsqu’il assigne aux seuils tels que les génériques ou les mentions paratextuelles (de fait linguistiques) une fonction énonciative (1991 : 68) : « Tout titre de film, au moment où il apparaît à l’écran, est enchâssé dans une phrase « profonde » comme Vous allez voir ». Si la présence du film comme film suffit à installer une deixis, alors la simplification théorique à viser (Hjelmslev) n’est en rien atteinte par la formulation d’évidences. C’est déjà ce que pointe F. Jost (1992 : 17) à propos de l’instance énonciative dont C. Metz (1968 : 29) dit qu’elle « est nécessairement présente et nécessairement perçue dans tout récit ». Or, le glissement de nécessairement présent à nécessairement perçu est une sortie des conditions de description sémiotique puisque, dit F. Jost (1992 :17), « la phénoménologie s’appuie sur une ontologie ». Ce que voit très bien F. Jost, c’est que la simplification par l’aplat de l’évidence n’est pas du tout une simplification heuristique. On en arrive à tout simplement ne plus pouvoir dire quoi que ce soit en raison du postulat machinique puisque, comme le relève F. Jost (1992 : 31), « si le texte est une chose, il ne faut même plus parler d’énonciation ».
Par ailleurs, les différentes manifestations ou les déclinaisons du Je semblent elles aussi poser un problème de simplification, i.e. de réduction. Dans son commentaire de l’ouvrage, J. Fontanille signale que la multiplication des instances ne résout rien puisque c’est finalement la combinatoire qui fait la particularité de l’instance.
1.2.4. Stabilisation, donc généralisation
En outre, la généralisation vers laquelle tendre bute sur la variabilité des figures de l’énonciation (Metz 1991 : 31). Ne faudrait-il pas acter l’impossibilité de leur inventaire puisque l’énonciation (1991 : 36) est « coextensive au film […] : pas toujours marquée, mais partout agissante ». Ainsi, du regard cinéma, dont C. Metz indique, s’appuyant sur A. Gaudreault, qu’il est un procédé très fréquent et banal du cinéma des premiers temps. En fait, les motifs types de l’énonciation sont engagés dans un mouvement diachronique, plus ou moins long, qui pose un problème pour la description systémique et ses niveaux. Il peut se produire ce que relève C. Metz (1968 : 120) : certaines figures telles que le fondu enchaîné qui apparaissent d’abord comme des connotateurs sont ensuite reversés au « schéma d’intelligibilité » de la sémiotique dénotative.
2. Vers une théorie énonciative procédant de la subjectivation
Sur les options de recherche, J. Fontanille (1994) suggère d’en traiter deux séparément : (i) les modes de manifestation et d’inscription de l’activité d’énonciation dans le discours, ce qui revient au simulacre méta-discursif, aux opérations embrayage-débrayage et aux motifs types ; (ii) le contenu de l’activité énonciative en général (ce qu’il va appeler praxis énonciative). Or, déjà, J. Fontanille (1994 : 194) envisage l’énonciation en tant qu’usage susceptible de modifier les processus de construction et de figement énonciatif ou de déconstruire les produits de l’activité énonciative. De son côté, F. Jost propose de faire l’étude des instances narratives et de travailler la subjectivité comme phénomène langagier puisqu’il constate (1992 : 82–83), à raison, que l’attribution impersonnelle de l’énonciation n’invalide pas toute perception de subjectivité.
La seconde partie de mon propos va concerner la possibilité d’inscription de l’énonciataire dans l’activité d’énonciation ainsi que la manière dont peut œuvrer la subjectivation, en tant qu’inscription d’une sphère d’engagement subjectale. F. Jost critique justement la conception automatique du rapport entre foyer et source, incapable de traiter le processus d’identification au récit, les projections spectatorielles ou les évaluations. Pour renchérir, on voit mal comment, loin de toute réduction à un encodage–décodage, la théorie du signal saurait rendre compte d’une élaboration qui s’ajuste toujours dans le cours de son action.
Les relations énonciatives possibles sont au nombre de trois : entre les deux partenaires de l’énonciation (sous une forme majoritairement indirecte) ; entre l’énoncé et l’énonciateur (sous la forme d’opérations, de traces ou de glissements) ; entre l’énoncé et l’énonciataire.
2. 1. Soutenir la thèse de la subjectivation
Tout d’abord, je souscris à cette idée de D. Château (2011 : 10) selon qui « de même, un film n’est rien s’il n’est reçu par une subjectivité, mais n’est rien non plus s’il n’existe objectivement ». Pour nuancer son propos, un film non vu reste au stade de la disponibilité, alors que le spectateur, en le voyant, l’actualise.
En revanche, je ne suis pas d’accord ni avec F. Jost (1992 : 67) ni avec C. Metz qui affirment tous deux que l’énonciation au cinéma relève du métalangage en ce qu’elle renvoie au langage filmique avant de renvoyer à l’émetteur. Au contraire, mon premier postulat, symétrique de l’intentionnalité, est qu’un film procède d’une « destination ». J’emprunte le terme à C. Metz lui-même qui précise (1991 : 51) : « le spectateur-auditeur ne pense pas vraiment qu’on lui parle, mais il est assuré qu’on parle pour lui ». Ce n’est pas une distorsion de l’énonciation, juste une manière de la concevoir par ce qui la fonde. D’ailleurs, F. Jost (1999 : 54) me conforte dans cette affirmation : « si le terme d’énonciation a un sens s’agissant d’audiovisuel, c’est qu’aucune médiation, visuelle ou verbale, n’existe sans être adressée par des hommes à d’autres hommes ».
Mais comment ménager au spectateur une place qui, tout en restant dans une logique interne, rende compte des manières dont il va l’occuper selon la destination promise ? Je m’inspire d’une proposition d’A. Rabatel (2005 :101) qui distingue entre trois postures interactionnelles conciliables en succession : (i) la coénonciation (101) comme « co-production d’un point de vue commun et partagé », qui donne lieu à un phénomène d’accord ; (ii) la surénonciation comme « expression interactionnelle d’un point de vue surplombant dont le caractère dominant est reconnu par les autres énonciateurs », précisant qu’elle peut s’établir dans la suggestion ou dans l’implicite ; (iii) la sousénonciation comme « expression interactionnelle d’un point de vue dominé, au profit d’un surénonciateur » qui construit ainsi une objectivité apparente. Cette proposition revient, selon moi, à concilier instances et opérations tout en maintenant l’idée (nécessaire) que l’énonciation, quoiqu’inatteignable, est ancrée, originée au cœur du film. Les postures interactionnelles délimitent donc le champ de présence offert pour une subjectivation, qui n’est pas forcément subjective, mais qui procède d’un mouvement d’engagement ou, inversement, de désengagement (perceptif, passionnel). De même, un point de vue, même singulier, n’est pas forcément celui d’un personnage. Ainsi, écrit D. Château (2011 : 71), « l’interne montré dans un film n’est pas le résultat de l’action d’une véritable intériorité ; c’est plutôt l’inverse : il y a dans le film une certaine représentation qui suggère l’inférence de l’interne. La question qui se pose alors est de savoir si le spectateur est mis en position d’intérioriser à son tour cette inférence, c’est-à-dire de ressentir cet interne inféré dans sa propre intériorité ». Ainsi, dans Martha Marcy May Marlène (S. Durkin), les apparitions du gourou d’une secte dont une jeune femme vient juste de s’enfuir servent au spectateur autant à percevoir la profondeur de l’endoctrinement qu’à accompagner un processus hallucinatoire.
Le problème est que, tout en gardant son intérêt, la proposition d’A. Rabatel n’est pas suffisamment générale parce qu’elle soumet l’énonciation au seul point de vue. Ce non recouvrement a déjà été noté par N. Nel (1997 : 39) lorsqu’il signale que la relation entre énoncé et énonciation est celle de la « tension entre narratif et non narratif ».
2.2. L’effectuation de l’énonciation ou l’énonciation comme « effectuation »
Ne faudrait-il pas se dire que si l’on ne trouve pas l’équivalent des déictiques linguistiques, ce n’est pas parce que les déictiques sont spécifiques de la langue mais parce que l’on n’a pas transposé l’énonciation comme processus spécifique et que l’on a cherché à trouver des équivalences discrètes ? Relisons C. Metz (1991 : 43) : « à force de concevoir l’énonciation comme une mise à nu de l’énoncé […] on avait presque oublié que cet énoncé est cela même qu’elle produit, et que sa fonction principale n’est pas de révéler mais de fabriquer ». C’est très logiquement d’ailleurs que J. Fontanille (1994 : 190) suggère de « ne plus aborder la question de l’énonciation, même simulée, sous l’angle des instances (subjectives, notamment), mais sous celui des opérations de la simulation ».
À mon sens, il faut à présent s’interroger sur l’énonciation du point de vue de ce qu’elle fait du spectateur et de ce qu’elle lui suggère de fabriquer. Tout comme F. Jost avait reformulé la traditionnelle question de la définition (qu’est-ce que) en une question d’identification et de repérage (« Quand y a-t-il énonciation télévisuelle ? »), la question serait celle du comment. Comment y a-t-il énonciation audiovisuelle à destination de l’énonciataire ?
À cet égard, F. Jost propose la piste très stimulante de l’indication ou de la communication, arguant que (1992 : 43) l’illusion filmique fonctionne d’autant mieux qu’elle s’adosse à « la reconnaissance d’un univers cognitif commun ». Par ailleurs, lorsque F. Jost (1992 : 86) livre comme questions « Comment un film émeut le spectateur […]? Comment un cinéaste fait-il passer telle ou telle impression ? », le point de vue peut tout à fait y pourvoir. Mais si l’on élargit notre perspective, y compris dès le niveau perceptif, ce sera à condition de pouvoir doubler ou transformer le point de vue de (d’un personnage, généralement) en point de vue sur.
Si l’on cherche une théorie qui concilie la dimension générale et modélisante tout en posant l’énonciation comme processus conditionné par la relation, l’on trouve une conception développée par J.-F. Bordron (2003). Selon lui, la réalité textuelle (donc les points d’intersection de l’énonciation) recouvrent trois registres : un texte comme somme de ses énoncés ; une instance productrice qui réalise les procédures d’embrayage et de débrayage ; l’effectuation du texte qui « désigne les procédures d’ajustement entre l’énonciation et l’énoncé », procédures qui ont un aspect dynamique et forment un « espace de médiation ». Or, J.-F. Bordron souligne la singularité du processus d’effectuation puisqu’il suppose que l’on ait « simultanément un sens et la règle pour le comprendre ». Dans les manières de faire de la médiation, J.-F. Bordron donne trois types : l’analogie, le modèle et le simulacre. Pourtant, si ces types permettent en gros de se faire une idée des principes et régimes de construction de l’effectuation en tant de « modélisation interne » (l’analogie rapproche l’un et le multiple ; le modèle fait le lien entre le général et le particulier tandis que le simulacre assure la communication entre l’intérieur et l’extérieur), ils ne disent en rien de quoi est constituée ou par quoi passe l’effectuation. Or, si l’on peut admettre l’effectuation comme principe général de prise, nul doute aussi qu’il faut l’acclimater aux réalités médiatiques, du cinéma, de la télévision ou de tout autre contexte.
Aussi, je propose de considérer l’énonciation en tant qu’effectuation comme un acte qui engage le destinataire, indépendamment de sa réception effective, à trois niveaux : (i) par la médiation : par la sollicitation de sa perception, le spectateur fait l’expérience du film ou de l’émission de télévision ; (ii) par la configuration i.e. la construction cognitive des relations au film ou à l’émission comme histoire, diégèse, récit, genre, discours … ; (iii) par la pathémisation et l’axiologisation i.e. la mobilisation des affects et des valeurs.
Prenons le niveau de la médiation. Il se produit bien des effets de réglages par lesquels les spectateurs se mettent en phase avec ce qu’ils voient et entendent ou, à partir de cela. En quelque sorte, l’expérience offerte du film en déictise réellement le contenu fictionnel. Ainsi, projeter à un public la marche dans le désert de Gerry (G. Van Sant) ou l’incipit de Sombre (P. Grandrieux) c’est s’adresser à l’endurance de corps réels.
Le niveau de la configuration engage la manière dont le spectateur est positionné par rapport à la diégèse, aux personnages, aux genres, etc., et ce indépendamment du vrai et du faux ontolologique. Un cadre fictif invalide-t-il la possibilité de deixis énonciative ? Répondre par l’affirmative arrêterait ici toute réflexion. Inversement ou avec plus de nuances, la deixis énonciative vient du cadre d’interaction (ou d’interlocution) promis, entretenu voire consenti avec le spectateur à partir de la deixis suscitée depuis le film ou en parallèle.
Quant au dernier niveau, il mobilise chez l’énonciataire différentes possibilités de se mouvoir par rapport aux affects ou aux valeurs qui sont représentés et suscités. Dans Clean Shaven (L. Kerrigan), la stridence ou les bruitages indiciels incitent à se détourner, au nom de sa propre expérience d’un sonore désagréable, tandis l’application du protagoniste à s’arracher l’ongle prête plutôt à l’empathie, d’autant que la focalisation est supposée interne.
Évidemment, l’effectuation, pour réussir en tant que médiation, nécessite d’être investie, c’est-à-dire en termes sémiotiques, actualisée. La difficulté est que le spectateur, lui, ne laisse pas de traces alors même qu’il active le film et de façon non métaphorique. Trois limites s’opposent à évoquer ce travail spectatoriel : il est potentiel, invisible et donc seulement déductible. Symétriquement, ne faut-il pas déjà réussir à nuancer cette affirmation de F. Jost (1992 : 63), selon qui il est impossible de déceler un acte de langage au niveau de l’image, que ce soit parce qu’on ne pourrait pas trouver les différents degrés de force illocutoire, parce que la perception varie selon les spectateurs ou que le film ne possède pas de marqueur à l’instar de la langue. Pourtant, il existe la possibilité d’en affecter la substance (en insérant d’autres images qu’originairement filmiques dans le dispositif filmique) comme la forme (par des distorsions et jeux rhétoriques).
2. 3. Les combinaisons subjectales : entre subjectalité persistante et subjectivité diffuse
La dimension personnelle de l’énonciation va bien au-delà de la transposition de l’appareil formel de l’énonciation tel que l’a théorisé E. Benveniste. Dans son article, J. Fontanille (1994 : 190) évoque un double problème et une double dissymétrie : « entre une ‘énonciation sans personne’ (le processus en tant que simulacre) et un ‘spectateur sans objet’ (un spectateur pour témoigner de l’absence de ce qui s’affiche comme acte à travers le simulacre ». Or, je propose de changer de perspective puisque l’on n’est plus dans le simulacre d’une énonciation inaccessible mais dans la possibilité d’une effectuation.
Ce n’est pas tant la subjectivité qui compte que la subjectalité. Tout d’abord, le regard et l’écoute ne sont pas des automatisations mais des médiations prenant place au sein d’une médiation audiovisuelle. Ceci veut donc dire que la réception est elle aussi une médiation sous la forme d’un parcours sensoriel, cognitif et pathémique découpé à même une médiation proposée.
Ainsi, pour Martha Marcy May Marlène, la praxis énonciative consiste à inscrire le film comme une coulée de conscience. Ce que peut être le Je-ici et maintenant du spectateur faisant l’expérience du film dépend de la manière dont il accepte de se positionner face à Marta, qui est elle-même un Je : voudra-t-il être un Je comme Marta l’est ? Voudra-t-il devenir l’allocutaire de Marta lui laissant apercevoir son hallucination ? Ainsi, la composition subjectale est riche de ses combinaisons possibles : partant d’une auto-détermination périphrastique d’ego, nous allons vers une configuration complexe et relationnelle, où, en bout, se trouve le « je » du « il » ou du « on ».
Dans l’énonciation, à l’instar du Je « juxtadiégétique » manifesté par la voix-je de narration, ne peut-on envisager une simulation juxta-relationnelle plus large proposée au spectateur ? Ainsi, l’incipit The Tree of Life, convoquant un Je passionnel calqué sur le protagoniste, se distingue de celui de Melancholia (L. von Trier) qui, s’il propose une relation d’ordre analogique entre une mariée, un enfant et un processus de destruction, bloque leur mise en rapport diégétique.
Si je reprends les types de médiation de J.-F. Bordron, je peux considérer le processus de subjectivation comme une possibilité d’actualisation faite pour l’énonciataire, offerte selon les trois schémas et validée par l’appropriation ou invalidée par la distanciation. Dans le cas de l’analogie, je propose de parler d’inception, pour traduire ce qui est une naturalisation et une incorporation de quelque chose d’étranger comme sien. Par exemple, filmer en caméra portée favorise cette actualisation par le voir. Pour le modèle, je propose le terme d’individuation, au sens où un individu réalise en lui une idée générale ou une espèce. Ainsi, dans Jackie Brown (Q. Tarentino) ancrer la première rencontre entre Jackie et son chargé de suivi dans le regard de l’homme et la ponctuer musique largement sirupeuse saupoudre d’ironie cette situation type du coup de foudre. Et dans le cas du simulacre, je propose de traduire par introjection cette projection qui permet d’être, d’entendre et de voir (avec) ce qui est autre en sien propre. Tel est dans Libera Me (A. Cavalier) le procédé qui consiste à faire « compléter » par le spectateur les sons manquants des scènes de torture.
Conclusion
Cette réflexion ne renie pas C. Metz et constate même avec lui (1991 : 20) que « l’énonciation est l’acte sémiologique par lequel certaines parties d’un texte nous parlent de ce texte comme d’un acte ». Elle s’inscrit dans la ligne du dictionnaire Sémiotique (1986 :76) pour qui « une linguistique de l’énonciation doit se donner pour tâche la construction d’un système de représentation métalinguistique, apte à simuler de manière explicite les mécanismes cognitifs des sujets énonciateurs, accessibles à travers les textes, c’est-à-dire des ‘‘agencements de marqueurs’’ », proposant par contre d’ajouter l’énonciataire à l’énonciateur. Pour autant, elle affirme que l’énonciation n’est ni personnelle ni impersonnelle mais en prise avec une subjectalité dont l’emprise est portée par des rapports d’analogie, de modèle ou de simulacre.
Elle reste ouverte puisque seules apparaissent les versions positives et réussie des types de médiation. Être tout à fait exhaustif serait prévoir leurs contraires (détourner les yeux ou se boucher les oreilles face à un simulacre trop pressant, tel l’œil coupé du Chien Andalou) ainsi que les conditions de leurs échecs.
Bibliographie
BORDRON, Jean-François. 2003. « Analogie, modèle, simulacre : trois figures de la médiation ». In Modèles linguistiques, tome XXIV, fascicule 1, 21–34.
CHATEAU, Dominique. 2011. La subjectivité au cinéma. Représentations filmiques du subjectif. Rennes : PUR.
FONTANILLE, Jacques. 1994. « Des simulacres de l’énonciation à la praxis énonciative ». In Semiotica, 99, 1/2.
GREIMAS, Algirdas Julien et Courtés, Joseph. 1986. Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. Paris : Hachette.
JOST, François. 1992. Un monde à notre image. Énonciation, cinéma, télévision. Paris : Méridiens Klincksieck.
METZ, Christian. 1968. Essais sur la signification au cinéma. Paris : Éditions Klincksieck.
METZ, Christian. 1991. L’Énonciation impersonnelle ou le site du film. Paris : Méridiens Klincksieck.
NEL, Noël. 1997. « Les Séquences télévisuelles ». In Recherches en communication, n°8, 31–55.
RABATEL, Alain. 2005. « Analyse énonciative et interactionnelle de la confidence ». In Poétique, n°141/1, 93-113.